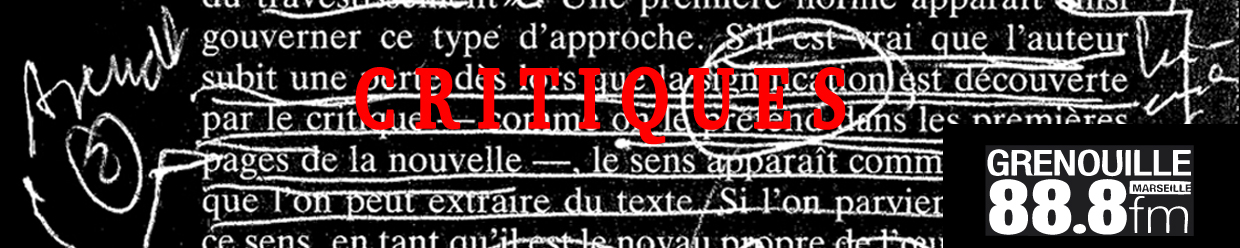Par Emmanuel Riondé
Le moment est proche où l’émotion légitime qui a saisi le pays ces six derniers jours va commencer à s’estomper. Vont alors se faire entendre les voix de celles et ceux qui vont nous demander expressément d’y demeurer le plus longtemps possible. Dans cet espace émotionnel confiné où l’on ne peut parler que de liberté d’expression menacée, d’attentats terroristes, de « jihadisme » et d’unité nationale. Depuis jeudi, cet espace porte un nom : « Je suis Charlie ». Et le sociologue Mathias Delori a fort bien mis en lumière les ressorts de l’« économie sélective de la compassion » qui y est aujourd’hui à l’oeuvre (à lire ici ).
Je ne suis pas Charlie et, comme d’autres (lire par exemple cette contribution du sociologue Saïd Bouamama), j’éprouve aujourd’hui le besoin de dire pourquoi.
Je ne suis pas Charlie parce que ce journal satirique avait cessé de me faire rire depuis longtemps. Les œuvres et les crobards de quelques uns de ses dessinateurs, oui, souvent. Mais pas sa ligne éditoriale. Au lendemain du 11 septembre 2001, l’hebdomadaire s’est irrémédiablement engagé, sous la houlette de son rédacteur-en-chef d’alors, Philippe Val, sur un chemin qui a souvent flirté avec l’autoroute de ce qu’il faut bien appeler l’islamophobie. Au point d’ailleurs que certains journalistes historiques du titre ont préféré s’en éloigner.
On peut, on doit pouvoir rire de tout, Charlie brocardait tout avec férocité, notamment les religions, et c’est bien pour cela qu’on a, un temps, aimé ce canard. Car, longtemps, ce fracassage joyeux et jouissif de toutes les autorités (familiale, morale, politique, religieuse, partidaire…) s’est épanoui dans le contexte d’une France dont il fallait faire voler en éclat le carcan conservateur: Charlie dézinguait les réacs et les coincés de tout bord, parlait de cul, de musique et de bonne chère, offrant chaque semaine dans les kiosques un véritable espace de respiration et de rigolade. Salutaire.
Mais le temps a passé et le contexte a changé. En France, depuis une quinzaine d’année, les citoyens de confession musulmane se sentent stigmatisés, montrés du doigt, suspectés. Ils sont régulièrement assignés (et cela devrait s’aggraver dans les semaines et les mois à venir) à se positionner par rapport aux agissements de groupes se réclamant de l’islam politique dans d’autres régions du monde. On ne demande pas à Paul de se désolidariser d’un tueur scandinave, héraut des valeurs du christianisme ni à Sara de critiquer les guerres israéliennes à Gaza mais on trouve normal que Mohamed soit sommé de condamner Al Qaeda au Maghreb islamique. Et l’on sait que sa cousine Farida est proche de Daesh, la preuve : elle porte un voile. La sociologue Nacira Guénif Souilamas a, avec d’autres, parfaitement dévoilé et déconstruit ces figures contemporaines du racisme anti musulman (notamment dans l’ouvrage La République mise à nue par son immigration qu’elle a dirigé, paru aux éditions La Fabrique en 2006, aujourd’hui épuisé) : côté pile, en négatif, la fille voilée (soumise et dominée) et le garçon arabe (« violent, violeur, voleur, voileur ») ; côté face, en positif, la beurette et le musulman laïc ; Tous « condamnés à exhiber une différence qui constitue leur unique espace d’existence sur le marché de l’identité française ».
Tout cela ne relève pas d’une construction imaginaire issue de l’esprit paranoïaque des musulmans de France. La montée et l’installation de l’islamophobie en France est une réalité bien tangible que relève année après année la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), institution publique que l’on peut difficilement taxée d’islamo-gauchisme. « Nouveaux avatars du racisme, l’Arabo-musulman et le Rom sont les cibles privilégiées de cette recrudescence de l’intolérance. Les études d’opinion traduisent également l’émergence d’un phénomène d’islamophobie et l’expression de plus en plus ostentatoire et banalisée des préjugés à l’égard des Roms, tandis que les statistiques du ministère de l’Intérieur enregistrent, cette année encore, une hausse des actes antimusulmans », relèvent, dans une note de présentation, les auteurs du dernier rapport sur « La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie » paru en avril 2014 et portant sur les chiffres et statistiques de l’année 2013 (rapport à télécharger ici ). Le Front National, sans jamais renoncer à taper sur « l’arabe » et « l’immigré » a nettement déplacé le curseur sur « le musulman » au cours des dernières années. Et le concept d’identité nationale mobilisé au plus haut sommet de l’Etat par Nicolas Sarkozy sous la forme d’un ministère a été le puissant vecteur dans la société française d’un repli excluant et d’une libération de la parole islamophobe et romophobe.
Ce changement de contexte, Charlie Hebdo n’a pas voulu ou pas su en tenir compte. Au cours des dernières années, beaucoup de musulmans se sont détournés de ses colonnes, blessés par le fait que dans une période aussi durement stigmatisante, ce journal, historiquement de gauche et donc théoriquement du côté des opprimés, ait jugé urgent de rejoindre la triste cohorte des chevaliers auto-proclamés d’une laïcité instrumentalisée jusqu’à la nausée. Paraissant incapable de se départir de grilles de lectures héritées d’un passé récent mais révolu, Charlie Hebdo a fini par faire de la défense, sincère et légitime, de la liberté d’expression et du droit à la caricature, une sorte de Veau d’or intouchable. Se détournant dans le même mouvement du nécessaire travail de réflexion politique que l’on pouvait attendre d’un titre se revendiquant aussi de valeurs libertaires et progressistes.
Pour cette raison et aussi parce Charlie Hebdo n’était pas Une seule plume mais bien une rédaction plurielle au sein de laquelle Val et Fourest ne sont pas et ne seront jamais ce qu’étaient Cabu et Wolinsky (beaucoup moins de talent et beaucoup plus d’avidité médiatique), je ne suis pas Charlie.
C’est avec rage et raison que l’on pleure aujourd’hui la disparition de journalistes qui, quelles que soient leurs idées, les défendaient avec des crayons et des claviers, froidement abattus par des tueurs au moment de la conférence de rédaction, le cœur palpitant d’un journal. Et il ne s’agit certainement pas de nier l’existence sur le sol français de personnes prêtes à passer à l’action violente au nom d’une lutte islamiste fondamentaliste. Ils sont là et il appartient aux services de renseignement et de police de savoir où et de les empêcher de frapper. Cet aspect des choses ne souffre aucune discussion.
Mais soyons lucide : beaucoup ont intérêt à ce que la tragédie qui vient de se passer se résume à ce simple énoncé: la liberté d’expression (et donc le « monde libre » – titre de Une du journal La Provence, lundi 12 janvier) attaquée par le terrorisme islamiste (porté par des « ennemis intérieurs », cf. Yves Thréard citant Manuel Valls dans son éditorial « Au nom de notre liberté », à la Une du Figaro du 9 janvier). Parce que cet énoncé simple, on le voit déjà, ouvre la voie à des réponses simplistes : la mise en place d’un Patriot Act à la française, la déchéance de nationalité (vœu d’Eric Ciotti, président UMP de la commission d’enquête parlementaire sur les filières djihadistes), l’instauration de prisons dédiées aux jeunes « djihadistes » et la mise en place de mesures pour les « déradicaliser » (pistes évoquées à peu près en ces termes par Thierry de Montbrial, sur BFM, mercredi 8 janvier au soir), ou même le déploiement de l’armée devant les écoles juives de France (Cuckierman du CRIF). Des réponses uniquement pénale, répressive, militaire, pas vraiment la promesse d’un avenir serein.
Et qui surtout, permettent, encore une fois, de ne pas répondre sur le fond à des questions identifiées de longue date mais qui continuent de fâcher.
Il en est une, profonde, qui appelle à un aggiornamento national autour de l’héritage colonial de ce pays. Les deux frères Kouachi, comme Amedy Coulibaly, comme Mohamed Merah en mars 2012 dans la région toulousaine, comme Boubaker el Hakim (directement impliqué dans l’assassinat des opposants Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi en 2013 à Tunis), sont des enfants de France. Tous issus de l’immigration postcoloniale, venant des quartiers populaires pour certains, pupilles de la nation pour d’autres. Ils appartiennent depuis leur naissance à la partie la plus stigmatisée de la population de ce pays, celle pour qui les valeurs républicaines et « l’unité nationale » mises en avant depuis une semaine, relèvent plus souvent de la fable que de la réalité. Celle qui, lors du soulèvement des banlieues en novembre 2005, s’est vue mise en « état d’urgence », une situation qui n’avait plus eu lieu sur le territoire national depuis… la guerre d’Algérie en 1961 (et entretemps en Nouvelle Calédonie en 1984). Cette dimension du problème, qui relève d’un impensé postcolonial, va-t-elle être abordée dans le débat ?
On sait aussi que les assassins de ces derniers jours se sont radicalisés dans les prisons françaises où ils ont notamment rencontré Djamel Beghal, activiste prédicateur redoutable, capable d’embrouiller des esprits fragiles. En l’occurrence ceux de « trois petits branleurs » qui ont ensuite « appris à manier la kalachnikov au Yémen » comme le résume efficacement l’universitaire Olivier Roy . Cette rencontre initiale n’a pas eu lieu dans un souk de Bagdad ni dans un camp d’entraînement en Afghanistan et elle n’est pas le fait d’un calife jihadiste, elle s’est déroulée dans les prisons françaises, à la faveur du surpeuplement pénitentiaire. Cette réalité va-t-elle être mise sur la table et couplée au débat sur la politique pénale et l’état des geôles françaises ? Pour l’heure, on a surtout entendu parler de régimes différenciés, de lois d’exception.
Enfin, Amedy Coulibaly ce vendredi et Mohamed Merah en mars 2012 ont tué des civils pour la seule raison qu’ils étaient juifs. Structurellement, la communauté juive ne souffre plus en France d’un antisémitisme largement diffus dans la société comme cela a longtemps été le cas. C’est désormais, on l’a dit, les musulmans (et plus récemment les roms) qui sont dans cette position. En 2003, 36 % des personnes interrogées considéraient les Juifs comme « un groupe à part » au sein de la société française; en 2013, ils ne sont plus que 26 % dans ce cas. Sur la même période, les Musulmans sont passés de 57 % à 55 % (rapport de la CNCDH déjà cité). Mais il est clair qu’au plan intime, aujourd’hui, être juif en France est en passe de devenir aussi angoissant qu’être musulman (pour plus de détails sur la réalité des chiffres de l’antisémitisme, voir cet article de Louise Fessard et Michel de Pracontal). Chacun doit bien prendre conscience de cette réalité. A commencer par les faibles d’esprit qui accordent encore du crédit politique à Soral (« qu’ils crèvent! » avait proposé celui-ci en 2011 en parlant de Charlie Hebdo, dans une vidéo) et Dieudonné (qui, lui, dit s’appeler désormais « Charlie Coulibaly »). A ces deux-là, on doit notamment d’avoir instrumentalisé la question de Palestine pour faire prospérer la haine du Juif. Le mouvement historique de solidarité avec la Palestine a toujours combattu et dénoncé cette confusion grossière, fait la chasse aux antisémites dans ses rangs et signé des communiqués extrêmement clairs à ce sujet. Pourtant, cet été, les manifestations pacifiques de soutien au peuple palestinien ont été interdites par un gouvernement français dont bien des membres se pressent chaque année au dîner du CRIF qui appelle régulièrement les « Juifs de France » à « faire bloc derrière Israël ». Vous avez dit confusion ?
Si l’on ajoute à cela l’engagement et le maintien de troupes françaises dans plusieurs pays d’Afrique (Mali, Centrafrique), anciennes colonies, on dispose là de quelques éléments (quartiers rélégués, prisons agissant comme des fabriques du crime, persistance d’une politique néocoloniale en Afrique et soutien constant à une occupation illégale au Proche-Orient) qui, ajoutés les uns aux autres, donnent non pas toutes mais quelques clefs pour comprendre pourquoi et comment la France de 2015 peut produire des monstres froids tels que Mohamed Merah ou Chérif Kouachi capables d’abattre une enfant de six ans dans une cour d’école ou d’achever un blessé d’une balle dans la tête.
En 2009, alors âgé de 27 ans, Amedy Coulibaly s’était rendu, au sein d’une délégation de jeunes, à l’Elysée face au président de l’époque, Nicolas Sarkozy (à lire ici ). Il était alors en contrat de professionalisation chez Coca-Cola. Quelques années plus tard, il a participé à la réalisation d’un petit film clandestin dénonçant les conditions de détention au sein de prison de Fleury-Mérogis (à voir ici ). Vendredi, on l’a vu foncer vers la vitrine d’entrée d’un magasin casher où, les heures précédentes, il avait tué quatre hommes juifs, des civils. Les policiers l’ont abattu. Et ce n’est pas juste un ancien petit voyou d’une cité de Grigny qui s’est alors effondré sur ce bout de trottoir, c’est la photo fanée d’une République juste, unie et égalitaire qui s’est retrouvée criblée d’impact de balle.
Depuis vendredi soir, la France a vingt cadavres muets sur les bras et pour s’en relever, il lui faudra autre chose que de vraies larmes aux yeux et de faux crayons pointés au ciel. Nous ne sommes pas Charlie, nous sommes un pays qui ne va pas très bien. Une partie des responsables de ce mal-être profond, et leurs brillants invités ont défilé dans le carré de tête de la manifestation parisienne de dimanche. Derrière, venaient des millions de personnes qui le temps d’un week-end ont eu la bonne idée de renvoyer la Le Pen à sa place : avec un petit millier de partisans esseulés dans un village du Sud-est de la France. Ce 11 janvier, la rue a demandé du commun et ce moment de catharsis collective est plutôt réconfortant. Pour qu’il soit fécond, il faut désormais quitter les rives de l’émotion, exiger une réponse politique et sociale forte et refuser fermement celle que l’on a déjà commencé à nous proposer : la « lutte contre le terrorisme », des policiers ici, des interventions militaires là-bas. Celle-là, on la connaît bien. Cela fait vingt ans que l’Occident nous la sert. Avec l’efficacité que l’on a pu constater, sidérés, ces derniers jours.